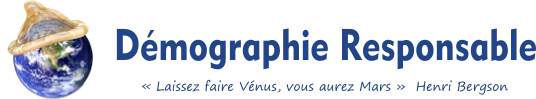Faut-il cesser d’avoir des enfants pour sauver la planète ?
Article de Joseph Confavreux paru le 19 septembre 2011 sur le site Médiapart
« Une planète plus déserte », « Pas de bébé à bord », « Stérile par choix », « Osez ne pas procréer », « Dépeuplez ! », ou encore « Free Space », finalement retenu. Tels sont les noms que les personnages du dernier roman de Jonathan Franzen, Freedom, envisagent pour baptiser le mouvement écologiste « néo-malthusien » qu’ils décident de fonder. La fresque politique du romancier américain place en effet, au centre de son intrigue, un petit groupe de militants de l’environnement qui jugent inévitable de restreindre la population mondiale pour sauver la planète. Walter, le théoricien de la bande, rend la surpopulation responsable de tous les maux environnementaux, et même sociaux, de la planète.
« Rien qu’en Amérique, dit-il, la population va augmenter de cinquante pour cent durant les quatre prochaines décennies. Pense donc au monde dans les banlieues résidentielles, pense à la circulation, à l’étalement des zones d’habitation, à la dégradation environnementale et à la dépendance du pétrole étranger. (…) Ensuite pense aux émissions de carbone dans le monde, au génocide et à la famine en Afrique, à la pêche sans limite dans les océans, aux colonies israéliennes illégales, aux Chinois Han qui oppriment le Tibet, aux cent millions de pauvres dans un Pakistan qui possède le nucléaire : il n’y a pas un problème dans le monde qui ne pourrait être résolu ou grandement atténué si on était moins nombreux.» Pour populariser leur idée, Walter et la jeune et jolie Lalitha, qui a décidé de se faire stériliser, essayent de convaincre le chanteur Richard Katz de mettre sa popularité au service de Free Space, comme Sting l’avait fait pour la forêt amazonienne…
Hors fiction, les militants d’une décroissance démographique sont encore loin d’avoir trouvé la grande voix susceptible de chanter leur cause. Si le livre de Franzen a été unanimement – et sans doute rapidement – décrit comme le grand roman américain des années Bush, il n’est pas certain qu’il soit encore visionnaire en matière de militantisme environnemental.
Dans le monde anglo-saxon où se sont développés les premiers mouvements inquiets des chiffres galopants de la démographie mondiale, à l’instar de l’Optimum Population Trust, ils demeurent minoritaires. En France, pays où la préoccupation et les politiques natalistes ont irrigué l’histoire, aussi bien sous Vichy qu’en République, ils sont embryonnaires. Seules quelques petites associations, comme Démographie Responsable, appellent à une restriction (volontaire) des naissances.
Et dans les rangs écolos, la proposition du député Yves Cochet, en 2009, de faire voter une directive qui inverserait l’échelle des prestations familiales en faisant décroître, au lieu d’augmenter, les allocations à partir du troisième enfant, n’a suscité que des sourires condescendants. Même au sein du mouvement plus radical de la décroissance, Paul Ariès a tenu à distinguer clairement celle-ci de la décroissance démographique, en publiant un ouvrage dont le titre résume assez bien la position : Pour sauver la terre, l’espèce humaine doit-elle disparaître ? De l’humanisme à l’humanicide : les délires terroristes des néo-malthusiens.
Ces voix minoritaires deviennent toutefois, progressivement, plus audibles. D’abord parce que la planète terre doit franchir, dans les prochaines semaines, le cap symbolique des 7 milliards d’habitants, pour atteindre 9 milliards à l’horizon 2050. Des chiffres qui suscitent un pessimisme croissant, exprimé de manière cinglante par Claude Lévi-Strauss qui déclarait en 2008 : « La question qui domine véritablement ma pensée depuis longtemps, et de plus en plus, c’est que, quand je suis né, il y avait un milliard et demi d’habitants sur la terre. Quand je suis entré dans la vie active, il y en avait deux milliards, et maintenant il y en a six milliards. Et il y en aura huit à neuf dans quelques années. Eh bien, à mes yeux c’est là le problème fondamental de l’avenir de l’humanité, et je ne peux pas, personnellement, avoir d’espoir pour un monde trop plein.»
L’inquiétude démographique, dominée par les questions d’alimentation dans les années 1960, a d’abord aujourd’hui pour corollaire une prise de conscience croissante des risques environnementaux, surtout lorsqu’elle s’appuie sur la notion d’empreinte écologique. Celle-ci mesure en effet l’activité humaine à l’aune de la surface de la planète utilisée, pour conclure, qu’à ce rythme de développement et de consommation, une seule planète ne suffira pas aux besoins prochains de l’humanité…
Mais cet activisme démographique anti-nataliste doit assumer une histoire douloureuse. Comme le résume le personnage principal du livre de Jonathan Franzen, « le contrôle de la population a pris un aspect terrible, politiquement parlant. La Chine totalitaire avec sa politique de l’enfant unique, Indira Gandhi et les stérilisations forcées, les malthusiens américains caricaturés comme nativistes et racistes. Les progressistes ont pris peur et se sont tus ». Une histoire difficile à évacuer, à laquelle s’ajoute le legs compliqué de Malthus lui-même, contestable à la fois politiquement et mathématiquement.
Malthusiens, néo-malthusiens et grève des ventres
D’abord, le pasteur britannique s’est trompé dans ses calculs, en ne prévoyant pas que les sauts technologiques en matière agricole seraient capables de nourrir une population en forte augmentation. Les progrès – notamment la mécanisation et les révolutions vertes – ne permettent pas d’opposer de manière binaire une population dont la croissance suivrait une courbe géométrique à des ressources alimentaires dont l’augmentation ne serait qu’arithmétique.
Ensuite, Malthus s’inquiétait avant tout de la croissance démographique des pauvres et du coût de l’assistance. Dans son Essai sur les principes de la population, publié pour la première fois en 1798, il écrit ainsi :« La pauvreté dépendante doit être tenue pour déshonorante. Si un homme qui voit le jour dans un monde déjà occupé ne peut obtenir sa subsistance de ses parents ou si la société refuse sa force de travail, il ne peut prétendre à la moindre portion de nourriture et il n’a, en fait, rien à faire ici. Au grand banquet de la nature, aucun couvert ne lui est réservé. Celle-ci lui commande simplement de s’en aller.» Ceux qui militent de nos jours pour un contrôle de la population sont d’ailleurs vite suspects d’un même élitisme, puisqu’on les trouve surtout aux États-Unis et en Europe, alors que l’essentiel de la croissance démographique se situe aujourd’hui au Sud et en Asie.
Ces militants dénatalistes contemporains devraient, à strictement parler, être qualifiés de néo-néo-malthusiens, puisque le néo-malthusianisme désigne, historiquement, un mouvement ouvrier, qui a pris forme à la charnière des XIXe et XXe siècles, en Grande-Bretagne et en France. Sous la houlette libertaire de Paul Robin, ce mouvement proposait une adaptation subversive de Malthus. Ce dernier avait, en effet, affirmé repousser « comme étant immoral (…) tout moyen artificiel et hors des lois de la nature que l’on voudrait employer pour contenir la population ». Il prônait la limitation morale, le recul de l’âge au mariage et l’absence de relations en dehors du couple pour préserver l’ordre et la hiérarchie sociale.
Ses impertinents disciples défendaient, eux, la« grève des ventres », par la contraception et l’avortement, comme moyen d’émancipation de la femme en général et de l’ouvrière en particulier, que les conditions matérielles obligeaient à trimer encore plus pour nourrir une famille trop nombreuse. Ils érigeaient donc le contrôle des naissances en vecteur d’agitation sociale et morale, sans parvenir, toutefois, à convaincre les marxistes qu’il pouvait exister une lecture émancipatrice de Malthus.
La pensée élitiste du pasteur britannique était trop ancrée dans les esprits pour imaginer un retournement de sa doctrine. Lénine avait ainsi dénoncé, dans un célèbre article intitulé La classe ouvrière et le néo-malthusianisme, ce qu’il considérait comme un péril: « C’est une chose que la liberté de la propagande médicale et la sauvegarde des droits démocratiques élémentaires du citoyen et de la citoyenne. C’en est une autre que la doctrine sociale du néo-malthusianisme. Les ouvriers conscients mèneront toujours la lutte la plus implacable contre les tentatives faites pour imposer cette doctrine réactionnaire…»
Cette histoire troublée de l’héritage malthusien rend plus difficile encore la cartographie politique des mouvements contemporains désignés comme néo-malthusiens, bien qu’ils soient quasiment tous liés à une forme d’inquiétude écologique.
Inquiétude réelle ou fantasmée ?
Quelles que soient leur place sur l’échiquier politique et leur activité réelle, ces mouvements sont le signe d’une inquiétude croissante, qui retrouve les préoccupations démographiques des années 1960 et 1970, lorsque Paul Ehrlich annonçait l’explosion, imminente, de la«Bombe P», ou lorsque le commandant Cousteau ou René Dumont, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle française, affichaient clairement leur volonté de maîtriser l’augmentation de la population.
Or, cette inquiétude, même si elle puise ses raisons dans l’état de la planète ou les projections des chiffres de la population mondiale, n’est pas tant l’expression d’une réalité démographique ou écologique que celle d’une perception culturelle. C’est tout l’intérêt de la monumentale enquête, parue au printemps dernier, de l’historien Georges Minois, que de faire l’histoire non pas de l’évolution de la population mondiale, mais de notre perception historique de cette démographie. Dans son ouvrage intitulé Le Poids du nombre. L’obsession du surpeuplement dans l’histoire, Georges Minois montre ainsi que, si le manque d’hommes a été une peur fréquente et récurrente, notre époque n’a pas le privilège de la crainte du trop-plein. « Platon s’en préoccupait déjà, recommandant un sévère contrôle de la natalité (…). Ceci à une époque où le monde ne comptait même pas 200 millions d’habitants. C’est dire que le problème du surpeuplement est plus affaire de culture que de chiffres », écrit l’historien. La peur du «trop-plein» a concerné aussi bien les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, les cités de la Grèce ancienne, l’Europe du début du XIVe siècle que notre monde contemporain…
Cette mise en perspective de l’histoire n’empêche toutefois pas la réalité, nouvelle, de compteurs affolants – 218.000 humains supplémentaires chaque jour – et d’une situation environnementale de plus en plus inquiétante.
Un autre ouvrage, tout récemment traduit en français, L’apocalypse démographique n’aura pas lieu. 7 milliards d’hommes sur la planète, du journaliste spécialiste de questions environnementales Fred Pearce, vise toutefois à rassurer le lecteur inquiet de se compter parmi une telle masse humaine. Bien qu’il soit lui aussi convaincu que « la surpopulation est le moteur secret de la destruction de l’environnement », il ne s’inquiète pas outre mesure. D’abord, constate-t-il, la transition démographique qui consiste, dans les pays développés, en un rapprochement progressif des courbes de natalité et de mortalité, est bien amorcée, y compris dans des pays comme l’Iran, certaines régions de l’Inde, la Birmanie, le Brésil ou le Viêtnam… L’augmentation exponentielle de la population est d’abord le résultat d’une forme d’inertie liée à ce que le nombre d’adultes en âge de procréer – et de jeunes qui le seront bientôt – n’a jamais été aussi élevé dans l’histoire de la planète. Il y a donc, selon lui, « fort à parier que les personnes qui ont moins de 45 ans assisteront au premier déclin démographique depuis la peste noire, il y a presque sept cents ans».
Un argument toutefois contesté par Lester Brown, auteur d’un ouvrage intitulé Beyond Malthus (Au-delà de Malthus), dans lequel il estime que les antimalthusiens font trop confiance à la transition démographique et minorent le risque que la surpopulation ne finisse par faire remonter la mortalité, du fait de la sous-alimentation, des épidémies et des conflits, au point de revenir à la situation de sous-développement de départ…
A l’appui de son argumentation, Fred Pearce souligne néanmoins aussi que la pression sur l’environnement est due à une surconsommation, davantage qu’à une surpopulation. Or, les espaces où la population augmente le plus rapidement sont aussi les plus pauvres, bien moins prédateurs pour la planète que les pays riches. Cette peur démographique serait donc possible à vaincre en adoptant un comportement plus sobre et moins frénétique. Enfin, Fred Pearce reprend le vieil argument opposé, post mortem, à Malthus, des progrès techniques et de la créativité humaine. « Notre espèce a déjà connu trois grandes poussées de population dans son histoire. Chacune d’entre elles s’est accompagnée d’innovations technologiques qui ont augmenté le nombre d’individus que la planète pouvait supporter », conclut-il.
« Et ils eurent beaucoup d’enfants… »
Ce dernier argument était déjà présent dans l’ouvrage d’Hervé Le Bras, paru en 1995, Les Limites de la planète, selon lequel « affirmer le primat du problème de la population, c’est, après le primat des armes, puis celui de l’économie, réduire une fois de plus la société à des facteurs physiques, c’est une fois encore prôner la domination des marchandises et des nombres sur les hommes et les idées ».
Il peine toutefois à convaincre complètement le lecteur que « l’apocalypse démographique n’aura pas lieu ». En effet, ce retour contemporain de la peur du surpeuplement, ancrée dans une inquiétude environnementale, est sans doute d’autant plus vif aujourd’hui que cette peur se déploie dans une crise parallèle de la notion de progrès : une partie de la crise écologique contemporaine étant précisément liée aux dégâts du progrès technique et industriel…
L’ouvrage de Georges Minois permet davantage de relativiser cette inquiétude contemporaine, en montrant que l’obsession du surpeuplement traverse l’histoire depuis les hommes du paléolithique jusqu’aux cités grecques du Ve siècle avant notre ère ou aux années 1960. Sans que le monde se soit pour autant effondré... Et il montre aussi à quel point la crainte inverse du «manque d’hommes» peut avoir, aussi, des soubassements culturels, puisqu’elle a très souvent été liée, dans l’histoire, à des politiques de conquête et de domination.
Mais ce livre révèle aussi à quel point les questions démographiques tissent préoccupations politiques et convictions intimes. Ainsi, lorsqu’il aborde l’époque contemporaine, Georges Minois semble se défaire de ses habits d’historien, et endosser un habit plus personnel, tant sa charge contre les arguments anti-malthusiens est violente. Il conclut d’ailleurs son ouvrage par une critique en règle de la culture nataliste française, synthétisée, pour lui, par ce détail révélateur : « La France est le seul pays où les contes de fées se terminent par la formule "Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants", comme si cela était indispensable au bonheur…»
Comme le remarque donc Georges Minois, « parler de surpeuplement touche aux conceptions fondamentales concernant la vie et la valeur ». Difficile alors d’évoquer la question de faire ou non des enfants – et combien ? – du seul point de vue de la préservation de la planète, tant les motivations d’enfanter obéissent aussi à des facteurs socioculturels ou des raisons singulières, comme le montre d’ailleurs le roman que Linda Lê vient de publier, A l’enfant que je n’aurai pas.
Mais l’entrée dans la sphère publique et politique d’une question aussi personnelle que celle de la procréation explique sans doute pourquoi Jonathan Franzen a voulu faire de cette intrigue néo-malthusienne un des pivots de son roman, parce qu'elle permet d’articuler une narration singulière et familiale à un portrait politique des années 2000.
|